Un texte de LÉO BEAUDOIN accompagné d’archives de la Ville de Montréal
Le nom de cette femme est omniprésent à Montréal : un parc au pied de la montagne, des monuments, un imposant complexe immobilier HLM au centre-ville, une rue qui traverse l’île dans sa largeur de même qu’un pavillon de l’Hôtel-Dieu perpétuent la mémoire de Jeanne Mance. Le gouvernement du Canada lui a même dédié, à Ottawa, l’immeuble de l’un de ses ministères. Ce n’est que justice. Co-fondatrice de Montréal, ses interventions ont, par la suite, sauvé le petit bourg du désastre; fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal, elle a fait l’objet d’un examen par un tribunal ecclésiastique, en vue de sa béatification. Personnalité atypique parmi les femmes de son temps, sa vie et ses œuvres ont suscité la curiosité de maints historiens et chercheurs.
Cofondatrice de Montréal
Lors des célébrations du 350e anniversaire de Montréal, en 1992, Jeanne Mance fut officiellement proclamée fondatrice de Ville-Marie à l’égal de Paul Chomedey de Maisonneuve. Ce ne fut pas un geste de complaisance aux mouvements féministes. La découverte de sources historiques inédites et une relecture des anciennes sous de nouveaux éclairages, qui font de l’histoire une science en perpétuelle évolution, ont permis de mettre en lumière le rôle de premier plan de Jeanne Mance dans la fondation et la survie du petit bourg qui deviendra Montréal.
Issue d’une famille aisée de Langres, en Champagne, Jeanne a 34 ans, en 1640, quand elle s‘interroge sur son avenir. Jusque là, elle a aidé son père veuf à l’éducation de ses frères et sœurs plus jeunes et s’est bénévolement dévouée auprès des blessés et des malades, en ces temps de fréquentes guerres et épidémies. Elle en a développé ce que l’une de ses biographes qualifie « la passion de soigner1 » et elle aspire maintenant à se vouer entièrement au service des souffrants. Pieuse, elle souhaite aussi se consacrer à Dieu mais le cloître ne l’attire pas. Ayant entendu parler des missions du Canada, elle se rend à Paris prendre conseil auprès des jésuites. Elle réside chez une cousine qui l’introduit dans la haute société de la capitale et même auprès de la reine, Anne d’Autriche. Le désir de cette «femme charmante2» d’aller soigner les sauvages du Canada suscite, dans les salons, curiosité et admiration.
Au même moment, à Paris, une association s’est formée en vue de réaliser un audacieux projet missionnaire dans la lointaine Amérique. Jérôme Le Royer de la Dauversière, percepteur d’impôts de La Flèche, en Anjou3, est à l’origine de cette association, qui porte le nom de Société Notre-Dame de Montréal. Il a réuni de riches laïcs et ecclésiastiques en vue d’acheter l’île de Montréal4, au Canada, pour y établir un poste voué à la conversion des autochtones. Un Père jésuite dirigea Jeanne Mance vers cette Société et quand il fit sa connaissance, Jérôme Le Royer fut immédiatement persuadé être en présence de la personne qu’il cherchait pour prendre soin des denrées et marchandises de la nouvelle colonie. Il lui proposa donc de se charger de l’intendance ou, si l’on veut, de la gérance de l’expédition dont Paul de Chomedey assurait la direction. Il l’invita, de plus, à se joindre à la Société Notre-Dame de Montréal.
Jeanne se révéla immédiatement la femme de tête qui la caractérisera5. Elle accepta la charge, après avoir consulté un Père jésuite; concernant son adhésion à la Société, elle en estima l’organisation peu structurée et demanda à Le Royer d’en préciser les buts et l’organisation. C’est ainsi que fut rédigé l’inestimable document intitulé Les Véritables Motifs des Messieurs de la Société de Notre-Dame de Montréal pour la conversion des Sauvages de la Nouvelle-France. Après l’avoir lu et demandé à son auteur de joindre le mot Dames à celui de Messieurs, Jeanne Mance s’assura que plusieurs copies fussent expédiées à ses connaissances de Paris, en vue de recruter de nouveaux membres.
À Québec, au cours de l’automne de 1641 et de l’hiver suivant, elle assume ses responsabilités de gérante, voyant au partage des vêtements, de la nourriture et des outils, pendant que Paul de Chomedey supervise l’abattage des arbres et la construction des chaloupes qui serviront au transport des marchandises et des colons, au printemps de 1642. Elle poursuivra cette charge de gérante à Ville-Marie, pendant que Chomedey érigera la palissade et les bâtiments du fort, organisera la défense de la jeune colonie et amorcera les premiers contacts avec les Hurons et les Algonquins des environs6.
En 1649, la gérante apprend que la Société Notre-Dame de Montréal fait face à de sérieuses difficultés internes susceptibles de mettre en danger l’existence de Ville-Marie. Sans hésiter, elle traverse l’océan, multiplie les démarches auprès de la Société Notre-Dame de Montréal, convainc M. Olier de prendre la direction des Associés et ceux-ci s’engager devant notaire à poursuivre l’œuvre7. De retour en 1650, elle trouve Ville-Marie sous la terreur des Iroquois. La situation devient à ce point désespérée que Maisonneuve abandonnerait tout si Jeanne Mance ne le persuadait de retourner en France y lever une nouvelle recrue. Elle prend sur elle de soustraire 22,000 livres, soit le tiers de la fondation de l’hôpital, quitte à faire approuver son geste plus tard par sa bienfaitrice. L’arrivée d’une centaine d’hommes, en novembre 1653, sera qualifiée de «seconde fondation de Montréal». Elle vient de sauver l’existence de Montréal pour la deuxième fois8.
À l’automne de 1662, Jeanne Mance entreprend un troisième et dernier voyage en France. Elle y trouve un pays transformé. Le jeune roi Louis XIV s’affirme et compte notamment faire de la Nouvelle-France une province de son royaume. Le mandat confié à l’intendant Talon est explicite à ce sujet: plus question d’un pays de mission. Par ailleurs, Jérôme Le Royer, Mme de Bullion, M. Olier et d’autres membres de la Société Notre-Dame de Montréal sont décédés. Constatant que les fins initiales de leur projet missionnaire sont devenues désuètes, les quelques associés de Notre-Dame survivants jugent bon de se dissoudre et de conférer leurs droits aux sulpiciens. Jeanne Mance est présente à cette séance de cession9.
De retour à Ville-Marie, la cofondatrice de Montréal voit défiler le régiment de Carignan vers l’Iroquoisie qui sera forcée d’accepter la paix, mais elle ressentira cruellement, peut-être davantage que l’intéressé lui-même, le limogeage de Maisonneuve, en 1665, par le marquis de Tracy. Elle devra aussi consacrer beaucoup de temps à justifier son administration auprès de Mgr de Laval. Celui-ci la rendait en quelque sorte responsable des conséquences, pour l’Hôtel-Dieu de Montréal, de la débâcle financière de Jérôme Le Royer, décédé à la fin de 1659. Le prélat n’acceptait pas ses explications au sujet des 22,000 livres confiées à Maisonneuve pour la Grande Recrue et fit partager à Jean Talon la méfiance qu’il éprouvait pour Jeanne Mance.
Fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal
C’est avant tout le soin des malades qui conduisait Jeanne Mance à Ville-Marie, au printemps de 1642. Elle avait accepté la gérance de l’entreprise sans toutefois renoncer à son projet d’hôpital. Une richissime veuve, la duchesse Angélique de Bullion, comptait sur Jeanne Mance pour établir, dans cette île, un hôpital dont elle assumerait les frais. À l’intérieur de l’enceinte fortifiée érigée par Chomedey sur le site qu’on appelle aujourd’hui «la pointe à Callière», Jeanne Mance a tôt fait d’aménager un dispensaire. Elle y soigne des Algonquins et des Hurons. Plusieurs de ces derniers demandent le baptême. Le projet missionnaire de Ville-Marie semble bien lancé. Dès le printemps 1643, toutefois, des bandes d’Agniers sèment la terreur autour du fort et les autochtones amis prennent la fuite.
Les Montréalistes heureusement en bonne santé et les Indiens absents, Jeanne Mance traverse dès lors une crise intérieure et songe à rejoindre les jésuites au pays des Hurons, dans la lointaine baie Georgienne. Elle demande à sa bienfaitrice l’autorisation d’y fonder l’hôpital plutôt qu’à Ville-Marie, mais Mme de Bullion s’y oppose. Jeanne se soumet, liant pour de bon son sort à celui de la colonie montréalaise11. Les escarmouches des Iroquois font des morts mais aussi des blessés qui tiennent le dispensaire occupé.
En juillet 1645, les Agniers font la paix. Jeanne Mance s’empresse de construire son hôpital, à deux arpents du fort : une maison de bois entourée d’une enceinte de pieux à laquelle on joindra plus tard une chapelle qui fera office d’église paroissiale. Elle est érigée où se croiseront les futures rues Saint-Paul et Saint-Joseph (aujourd`hui Saint-Sulpice) et le sentier qui la relie au fort est appelé rue de l’Hôpital. Les nations indiennes amies fréquentent de nouveau la colonie et le projet missionnaire semble de nouveau prometteur quand, à la fin de l’été 1646, les hostilités reprennent de plus belle et les Indiens amis fuient de nouveau. Au cours des prochaines années, l’hôpital ne chômera cependant pas: les blessés y affluent et, les attaques des Iroquois se faisant plus meurtrières, Jeanne Mance doit même, en 1651, se retirer à l’intérieur du fort. Son hôpital est transformé en redoute.
 L’arrivée de la Grande Recrue, en novembre 1653, sauvera Ville-Marie, mais sonnera le glas de l’épopée missionnaire. L’hôpital réalisera désormais sa mission dans un village à la fois garnison militaire, poste de traite et point de départ pour les grandes expéditions vers l’ouest. Jeanne Mance a 47 ans; il lui reste vingt ans de vie pour consolider son œuvre. Ces deux décennies ne seront pas de tout repos. En 1657, une chute sur la glace lui fracture l’avant-bras et le poignet droit, la laisse impotente et dans de continuelles souffrances. Incapable de poursuivre son travail d’infirmière, elle se rend de nouveau en France, en compagnie de Marguerite Bourgeoys, pour assurer sa relève. Elle recouvre l’usage de son bras auprès de la relique de M. Olier12 et revient à Ville-Marie en 1659, accompagnée des trois premières religieuses hospitalières de La Flèche.
L’arrivée de la Grande Recrue, en novembre 1653, sauvera Ville-Marie, mais sonnera le glas de l’épopée missionnaire. L’hôpital réalisera désormais sa mission dans un village à la fois garnison militaire, poste de traite et point de départ pour les grandes expéditions vers l’ouest. Jeanne Mance a 47 ans; il lui reste vingt ans de vie pour consolider son œuvre. Ces deux décennies ne seront pas de tout repos. En 1657, une chute sur la glace lui fracture l’avant-bras et le poignet droit, la laisse impotente et dans de continuelles souffrances. Incapable de poursuivre son travail d’infirmière, elle se rend de nouveau en France, en compagnie de Marguerite Bourgeoys, pour assurer sa relève. Elle recouvre l’usage de son bras auprès de la relique de M. Olier12 et revient à Ville-Marie en 1659, accompagnée des trois premières religieuses hospitalières de La Flèche.
Entre temps, les premiers sulpiciens sont arrivés à Ville-Marie pour assumer les fonctions pastorales auprès des Montréalistes, avant de devenir, en 1663, les seigneurs de l’île. Les Iroquois, de leur côté, reprennent le sentier de la guerre. La terreur qu’ils font peser de nouveau sur Ville-Marie n’est pas la seule épreuve de Jeanne Mance. Pour garder le contrôle de son hôpital, elle doit tenir tête au supérieur des sulpiciens, M. de Queylus, ecclésiastique riche et généreux mais d’une nature autoritaire, ainsi qu’à Mgr de Laval. L’un et l’autre souhaitent confier l’Hôtel-Dieu de Montréal aux Hospitalières de Québec plutôt qu’à celles de La Flèche. Au retour d’un troisième voyage en France, en 1664, la fondatrice ne sortira plus guère de son hôpital. Elle décédera à l’Hôtel-Dieu, en 1673, au milieu des religieuses hospitalières dont la Sœur Marie Morin et Dollier de Casson, le supérieur des sulpiciens, qui l’assista à ses derniers moments.
Indépendamment de toutes autres considérations et en dépit des indéniables qualités qu’il faut reconnaître à Jeanne Mance, doit-on entretenir quelque doute sur la rigueur de son administration ? Nul n’est parfait. Sœur Marie Morin, qui accédera plus tard aux fonctions d’économe, puis de supérieure de l’Hôtel-Dieu et qui professa par ailleurs une grande vénération pour les vertus de «Mademoiselle Mance», n’en a pas moins laissé cette remarque: …pour ce qui est de Mademoiselle Mance, qui auroit laissé les afaires de son hospital en meilleur estat qu’elle n’a fait sy elle avoit esté plus mesnagère, qui estoit sur le bord de la ruine quand elle mourut13.
LÉO BEAUDOIN
__________
*Texte revu et corrigé d’un article publié dans la parution de février 2005 du journal Le Vieux-Montréal, sous le titre Qui se souvient de Jeanne Mance ? 1606-1673
Notes et références :
- Françoise Deroy-Pineau. Jeanne-Mance. De Langres à Montréal, la passion de soigner. Montréal, Éditions Bellarmin, 1995,
- ibid., pp. 28, 51.
- Jérôme Le Royer était un ancien élève du collège des jésuites de La Flèche où avaient résidé ou enseigné des missionnaires du Canada. La lecture des Relations y suscitait admiration et enthousiasme pour ces missions lointaines.
- Lors de la création de la compagnie des Cent Associés par le cardinal Richelieu, en 1627, de vastes étendues de terrain avaient été concédées en seigneuries. Incluse dans l’une d’elles, l’Île de Montréal devait être acquise de son propriétaire. Robert Prévost. Montréal, La folle entreprise. Montréal, Stanké, 1991, p. 36. Dom Guy-Marie Oury. Jeanne Mance et le rêve de M. de la Dauversière. Chambray, C.L.D. éditeur, 1983, p. 57.
- Sœur M. Mondoux, rhsj. L’Hôtel-Dieu, premier hôpital de Montréal. Montréal, Hôtel-Dieu de Montréal, 1942, p. 88. Dom Guy-Marie Oury. Op. cit., p. 67. Voir aussi François Dollier de Casson. Histoire du Montréal de 1640 à 1672.Texte adapté et commenté par Aurélien Boisvert, LL.L, DDN, Montréal, Les Éditions 101 Enr. 1992, p. 27.
- Marie-Claire Daveluy. Jeanne Mance. Montréal, Éditions Fides, 1962, pp. 71 ss.
- Pierre Benoit. La vie inspirée de Jeanne Mance. Montréal, Éditions Albert Lévesque, 1934, p. 141. Marie-Clauire Daveluy (1962), p. 117 ss. Marie-Claire Daveluy. Mance, Jeanne. Dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne.
- Marie-Claire Daveluy, (1962). chapitre IX.
- Pierre Benoit. Op. cit., p. 125. Marie-Claire Daveluy (1962), chapitre XXI.
- Marie Morin, rhsj. Histoire simple et véritable. Édition critique par Ghislaine Legendre. Montréal, Les Presses de l’U. de M., 1979, p. 70.
- François Dollier de Casson. Op. cit., p. 52.
- Dr Marcel Cadotte, m.d. Jeanne Mance: un diagnostique médical après trois cents ans. Dans Les Origines de Montréal. Collectif sous la direction de Jean-Rémi Brault, Montréal, Leméac, 1993, pp. 149-159. Marie Morin. Op. cit., pp. 82, 83.
- Marie Morin. Op. cit., p. 68.



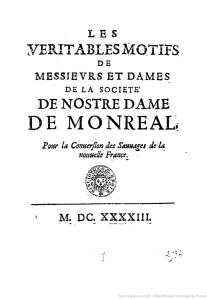














![Jacques Viger, [18-], BM1,S5,P2202 Jacques Viger, [18-], BM1,S5,P2202](https://montrealaisdautrefois.files.wordpress.com/2010/11/p2202-31.jpg?w=207&h=300)
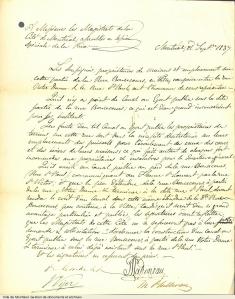

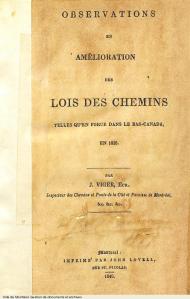

![Premières armoiries de Montréal (image tirée de l'album Souvenirs canadiens , [183-], BM99,S1,D1 Premières armoiries de Montréal (image tirée de l'album Souvenirs canadiens , [183-], BM99,S1,D1](https://montrealaisdautrefois.files.wordpress.com/2010/11/armoiries-10ajus1.jpg?w=296&h=300)
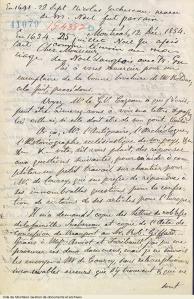

![Jacques Viger, [19-], VM6,S10,D026.1-3 Jacques Viger, [19-], VM6,S10,D026.1-3](https://montrealaisdautrefois.files.wordpress.com/2010/11/d026-1-3-002.jpg?w=239&h=300)


